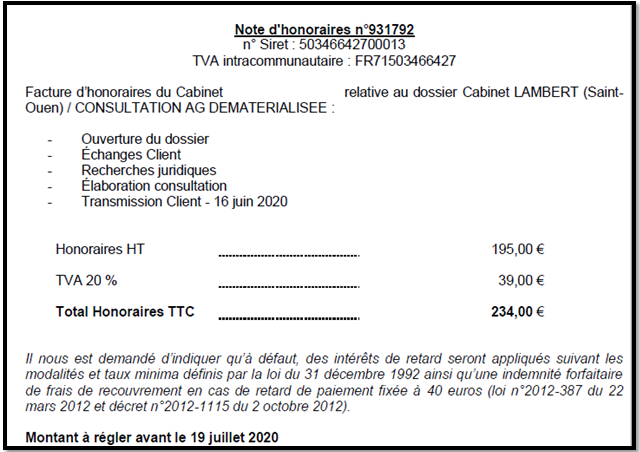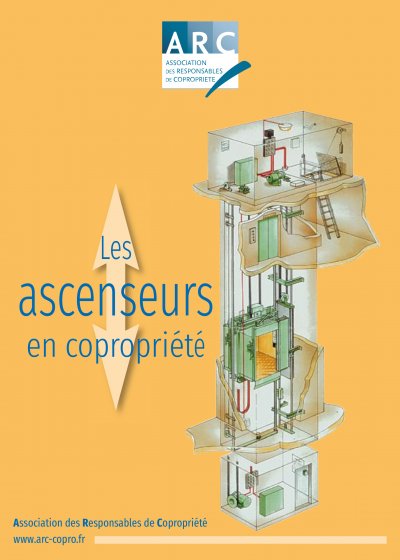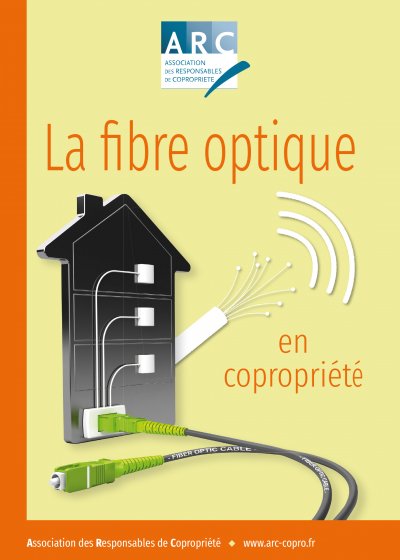Les règles pour obtenir une deuxième décision de justice en condamnation au paiement des charges de copropriété nées postérieurement à la première décision
Il est tout à fait possible d'obtenir des décisions de justice successives d'un copropriétaire débiteur le condamnant au paiement de sa dette qui augmente.
Les juges doivent opérer un contrôle effectif entre la décision rendue antérieurement et le décompte soumis pour obtenir la condamnation au paiement de la nouvelle dette créée après le premier jugement.
Les impayés de charges de copropriété sont les cauchemars des syndicats de copropriétés. En effet, cela fragilise la trésorerie de la copropriété au point dans certaine situation de ne plus pouvoir faire face au paiement des prestataires, ni aux factures de fournisseurs.
Dès lors, quand un impayé apparait, le syndic doit être très réactif pour parvenir à obtenir le paiement des charges de copropriété. Soit le syndic arrive à obtenir amiablement le paiement des charges, soit il est obligé d’obtenir une décision de justice qui condamnera le copropriétaire défaillant au paiement des charges de copropriété.
Parfois, malgré l’obtention d’une première décision et des paiements partiels du copropriétaire, la dette ne cesse d’augmenter. La décision judiciaire condamne à payer une somme arrêtée à une date précise, le syndic est obligé d’engager une nouvelle action pour obtenir le paiement de la « nouvelle dette ».
C’est ainsi, que la Cour de cassation dans son arrêt du 12 mars 2020 (n°18-24867) nous apporte des précisions concernant l’obtention d’une deuxième décision condamnant le copropriétaire débiteur au paiement des sommes dues postérieurement.
I. Le recouvrement judiciaire des impayés
Au sein d’une copropriété, un copropriétaire ne paie pas ses charges. Le syndic, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires assigne le débiteur pour obtenir une décision de justice le condamnant au paiement des sommes réclamées. Le juge ordonne la condamnation du copropriétaire au paiement de la somme de 11.389.72€ arrêtée au 09 décembre 2010.
Il appartient exclusivement au syndic de recouvrer les impayés de charges. Pour cela, il doit se conformer aux éventuelles règles mentionnées dans le règlement de copropriété pour recouvrir les charges. Dans le cas contraire, il est préférable que l’assemblée générale vote un protocole mettant en place une procédure à respecter pour le recouvrement des charges impayées.
Si le syndic doit tout d’abord tenter de recouvrer amiablement les impayés, cela ne suffit pas toujours. Dans ce cas, il doit passer par la phase judiciaire.
En tant que représentant légal de la copropriété, c’est le seul à pouvoir saisir la justice, au nom du syndicat des copropriétaires, pour les impayés.
Pour les actions en recouvrement, le syndic n’a pas besoin d’être habilité par le syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire que le syndic n’a pas besoin d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale pour engager une action judiciaire.
Par ailleurs, la réforme de l’organisation de la Justice a prévu une procédure accélérée pour le recouvrement des charges. Pour ce faire, le syndic doit saisir le Président du Tribunal judiciaire statuant en procédure accéléré au fond.
Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2020 (date d’entrée en vigueur de la réforme de la Justice) pour toutes les créances inférieures à 5000€, une conciliation judiciaire préalable à l’audience est obligatoire. Concrètement, le Tribunal donne une première date de conciliation, puis une date d’audience.
Dans cet arrêt, un premier jugement condamne le copropriétaire débiteur au paiement de la somme de 11 389.72€ arrêtée au 09 décembre 2010. Néanmoins, après cette date, une nouvelle dette se forme et s’ajoute à celle à laquelle il a été condamné préalablement.
II. La règle pour obtenir une deuxième condamnation au paiement pour les impayés nés postérieurement à la première décision
Quatre ans après la décision condamnant le copropriétaire débiteur au paiement des charges impayées à la somme de 11 382.72€, ce dernier doit à la copropriété la somme de 11318.82€ au 03 avril 2014, malgré des paiements partiels effectués.
Devant une telle somme, le syndic assigne une nouvelle fois ce copropriétaire. En effet, la première décision de Justice ne condamnait le copropriétaire à une somme déterminée et précise. Ainsi, le copropriétaire est redevable de la somme arrêtée à cette date. S’il ne paie pas les charges nées postérieurement à cette décision, celle-ci ne peut s’appliquer.
Pour ce faire, le syndic doit demander une nouvelle condamnation au paiement, en produisant un décompte laissant apparaitre que le début de la dette commence après la première condamnation. En effet, le copropriétaire ne peut être condamné deux fois à payer la même somme.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel rejette la demande de condamnation au paiement des charges de copropriétés impayées. En effet, elle compare les deux sommes dues soit 11 389.72€ en 2010 et 11318.82€ en 2014 et considère que le syndic n’a pas déduit la somme à laquelle le copropriétaire avait été condamné pour la première décision.
Or, elle ne vérifie pas les décomptes mais effectue uniquement une comparaison.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel « en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si le solde au 03 avril 2014 ne correspondait pas en tout ou partie, après imputation des paiements à l’apurement de la précédente condamnation, à des charges postérieures au 09 décembre 2010 ».
Ainsi, la Cour de cassation indique qu’il faut faire un contrôle effectif du décompte. Surtout, si le copropriétaire paie partiellement sa dette, il ne faut pas oublier que chaque paiement s’impute en premier sur la dette la plus ancienne. Le juge doit vérifier la véracité des décomptes.
Dès lors les syndics doivent être très vigilants dans l’élaboration de leur décompte au risque d’être débouté par le juge.