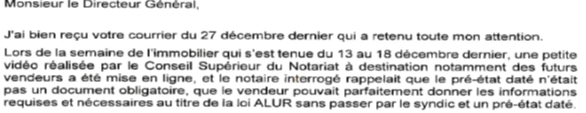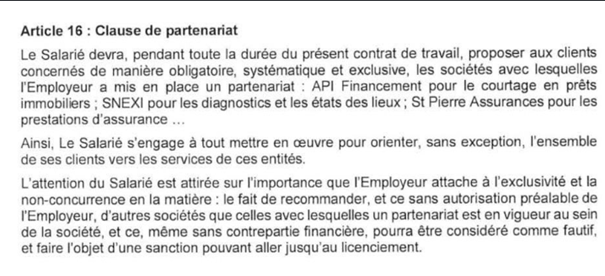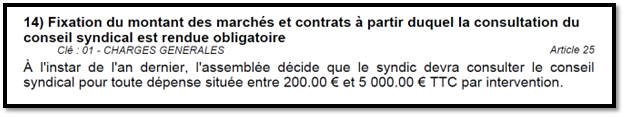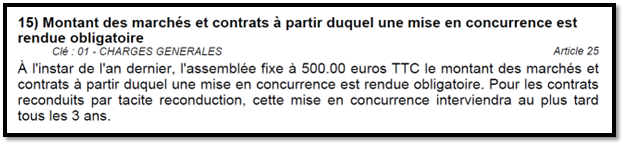Quand doit être rédigé l’original du procès-verbal de l’assemblée ?
La rédaction de l’original du procès-verbal de l’assemblée suscite des interrogations. Les usages et interprétations douteuses de syndics professionnels expliquent en partie ces questionnements. A quel moment s’impose réglementairement l’établissement du compte-rendu de l’assemblée ?
I. La rédaction de l’original du procès-verbal s’effectue en fin de séance
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose, que l’établissement de l’original du procès-verbal de l’assemblée sans distinction (qu’il soit dactylographié ou manuscrit) s’opère :
- à l’achèvement de cette réunion du syndicat ;
- par le secrétaire, le syndic, sauf décision contraire des copropriétaires (art. 15 du même décret).
En tant que garant de la régularité de l’assemblée, le président de séance (art. 15 du décret précité), possédant nécessairement un lot sur la résidence concernée (Cass. 3e civ. 6 mars 2002, n° 00 - 10406) supporte, à cette occasion, de contrôler de sa conformité au regard :
- des prescriptions réglementaires [décision sous chaque, question, avec indication du nom et du nombre de voix des opposants (mentionnant leurs éventuelles réserves sur la régularité de la résolution), des abstentionnistes, des assimilés aux défaillants (copropriétaires s’exprimant favorablement sur son formulaire de vote sur un projet amendé en cours de réunion)] ;
- des impératifs légaux et conventionnels (majorité licite, application de la bonne clé de répartition stipulée par le règlement de copropriété) ;
- de la teneur des débats.
Pour ce faire, le président est assisté d’un ou plusieurs scrutateurs, si le règlement de copropriété impose cette fonction, Cass. 3e civ. 22 novembre 2006, n° 05 - 19042. Dans la négative, une telle nomination s’avère, certes recommandée, mais néanmoins strictement facultative.
En présence d’une irrégularité sur ce compte-rendu d’assemblée, le président de séance, devrait immédiatement exiger, du secrétaire de séance, les corrections appropriées, avant d’y apposer sa signature, tout comme celle des autres membres du bureau (art. 17 du décret susnommée).
De plus, le président de séance pourrait requérir, à cet instant, une copie (papier, voire photo, en l’absence d’imprimante disponible) de ce document, afin de se garantir contre la diffusion ultérieure d’une version divergente du syndic. En effet, si le syndic a la possibilité de notifier, aux copropriétaires opposants, défaillants ou assimilés une version dactylographiée du procès-verbal de l’assemblée (en cas d’original manuscrit), la jurisprudence requière une concomitance sur le fond entre ces deux supports, Cass. 3e civ. 22 octobre 2009, n° 08 - 22099.
II. La signature par le bureau de l’original du procès-verbal de l’assemblée peut être décalée
Dans la mesure où l’article 17 du décret du 17 mars 1967 est assez précis, d’où viennent les confusions en la matière. Cette disposition prévoit la rédaction du procès-verbal lors de l’assemblée, ainsi que sa signature ou le renvoi de cette dernière formalité dans les huit jours de sa tenue.
Dès lors, certains syndics prétendent que ce délai consenti permettrait :
- a minima d’apporter postérieurement toute modification souhaitée au compte-rendu initial ;
- a maxima de rédiger ultérieurement le document original, en se contentant lors de l’assemblée, de la signature des membres du bureau sur la dernière page précisant leur qualité et l’heure de clôture de cette réunion.
Cette interprétation se révèle juridiquement litigieuse, dans la mesure où :
- l’article 17 du décret suscité concède explicitement, comme seule option, le report des signatures ;
- l’absence d’établissement de l’original du procès-verbal au jour de l’assemblée, expose celle-ci à son annulation judiciaire dans son intégralité, Cass 3e civ. 20 décembre 2006, n° 05 - 20384 ;
- elle favorise ultérieurement des différends sur le sens des résolutions, voire la contestation judiciaire des copropriétaires.
Comment expliquer cette faculté de décaler la signature de l’original du procès-verbal ?
Cette prérogative relativement récente (modification de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 par un article 18 d’un décret du 2 juillet 2020) se justifie essentiellement par la possibilité, du président, d’un ou plusieurs scrutateurs, de participer à distance à l’assemblée, via principalement la visioconférence (art. 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965). En conséquence, ce ou ces membres du bureau se trouvent dans l’incapacité de signer l’original du compte-rendu en fin de séance, puisqu’ils ne sont pas présents physiquement à cette réunion du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’assemblée, il revient au président de séance, épaulé par un ou plusieurs scrutateurs, de vérifier la correspondance de l’original du procès-verbal de l’assemblée rédigé par le secrétaire. Dans l’hypothèse d’une ambiguïté ou d’une erreur, le président réclamera les rectifications adéquates du secrétaire, avant tout départ de celui-ci de la salle de réunion.