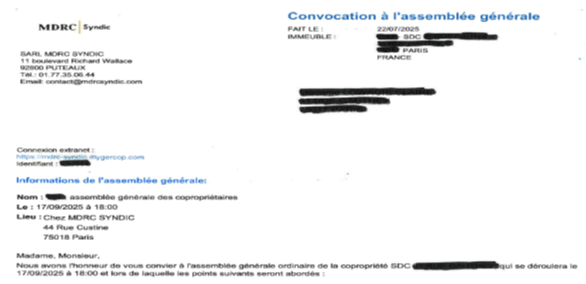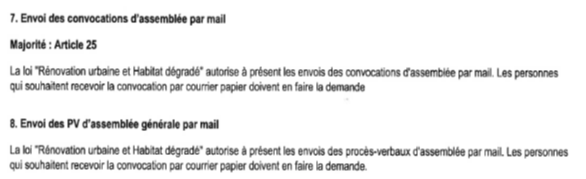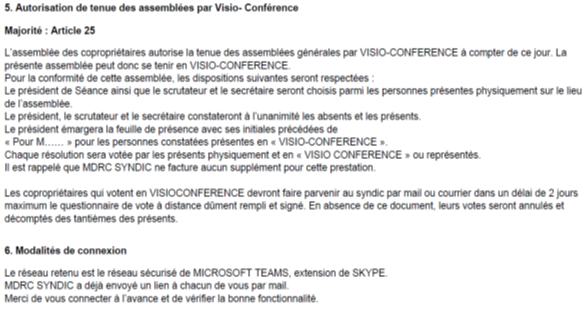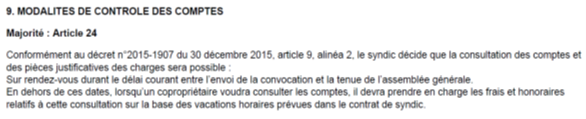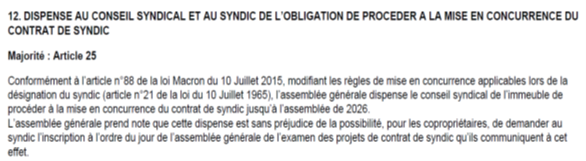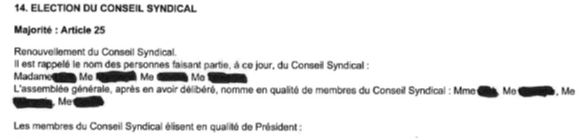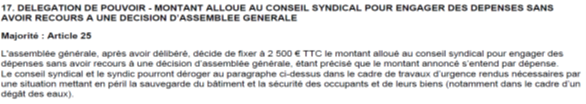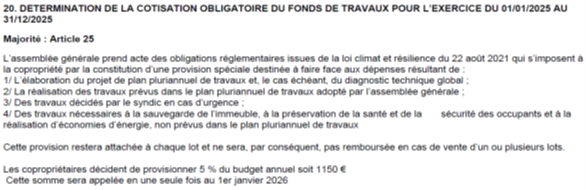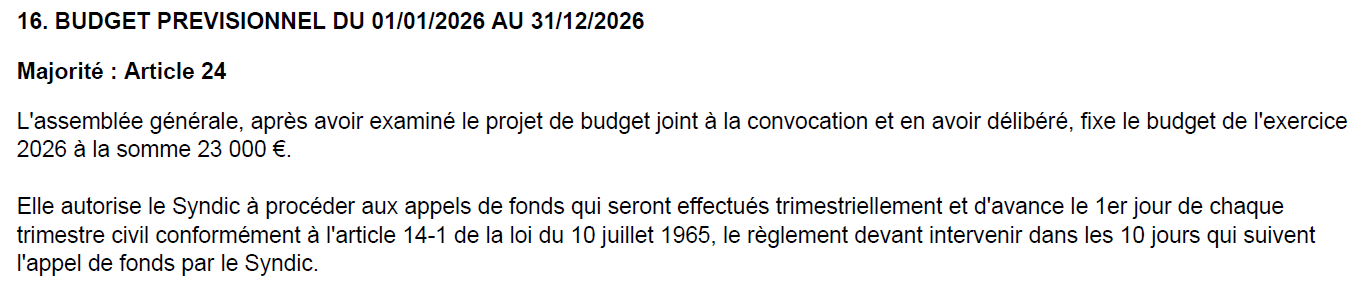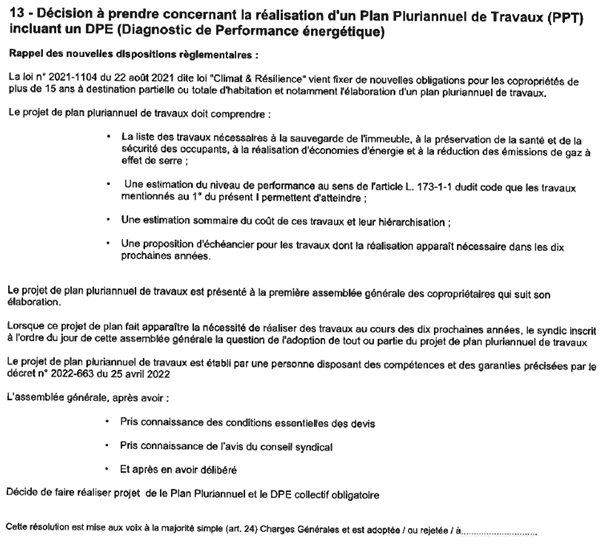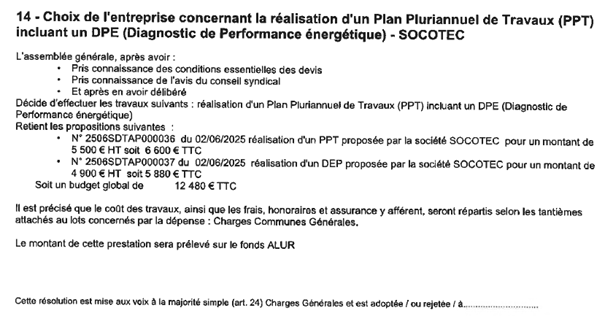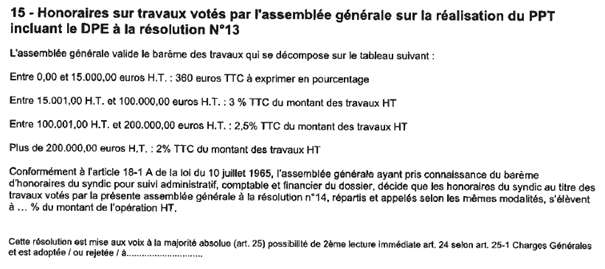Nouvelle condamnation in solidum d’un syndic et de son assureur d’un montant de 6 735 euros pour défaut de remise des pièces au conseil syndical
L’un des objets de l’ARC Nationale est de défendre sans compromis les intérêts des syndicats de copropriétaires.
Beaucoup pensent que cela se fait au détriment des syndics professionnels.
Il s’agit d’une erreur d’analyse car, à décevoir certains, l’ARC Nationale dialogue avec les bons syndics et même encourage les copropriétaires à payer le travail en valorisant les honoraires du forfait de base.
Cela étant dit, l’ARC Nationale utilise plusieurs leviers pour défendre les syndicats des copropriétaires face à des syndics peu scrupuleux qui sont souvent extrêmement puissants et qui disposent d’un mandat difficilement résiliable.
Pour cela, il y a la voix législative en proposant de réformer certains textes qui sont incontestablement déséquilibrés au profit des syndics professionnels.
En parallèle, il y a une autre seconde voie moins connue qui est le financement par l’ARC Nationale de procédures judiciaires au profit des syndicats des copropriétaires adhérents.
C’est dans ce cadre que l’ARC Nationale a financé plusieurs procédures pour notamment faire condamner le syndic à payer des pénalités de retard pour défaut de remise de pièces réclamées maintes fois par le conseil syndical.
En décembre 2024, le cabinet VILOGIA PREMIUM a été condamné à payer 9 930 euros de pénalités de retard auxquels s’ajoute une obligation de transmettre les documents réclamés sous peine d’astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour. (voir article à partir du lien suivant : arc-copro.com/wfdb)
En juillet dernier, nous avons obtenu une nouvelle décision toute aussi percutante qui commence à créer de la doctrine sur ce type de procédure.
Voyons cela de plus près en commençant par rappeler le cadre juridique.
I- Des pénalités à hauteur de 15 euros par jour de retard
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne un droit au conseil syndical de réclamer au syndic une copie de tout document ou correspondance qui concernent la copropriété.
Dans la mesure où le syndic refuse ou tarde à remettre les documents au-delà d’un délai d’un mois, des pénalités d’un montant de 15 euros par jour de retard se comptabilisent.
Ces pénalités doivent être déduites des honoraires de base lors de l’arrêté des comptes.
Dans la mesure où le syndic refuse d’imputer ces pénalités, le président du conseil syndical est habilité à engager une procédure judiciaire en saisissant le président du tribunal judiciaire (sans obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale) pour demander la liquidation de ces pénalités.
Plusieurs actions ont été engagées et financées par l’ARC Nationale avec des décisions judiciaires très intéressantes que ce soit sur les motifs évoqués mais également sur les condamnations prononcées.
Et pour cause, dans une affaire, le syndic a refusé de remettre les pièces en prétextant la protection des données.
Le Juge a rejeté cet argument au motif que la protection des données ne pouvait pas faire obstacle au pouvoir du conseil syndical de réclamer à son syndic des pièces qui concernent la copropriété.
Une nouvelle affaire a apporté d’autres précisions toutes aussi importantes.
II - Une condamnation in solidum du syndic et de son assureur
À la suite d’une action engagée par le président du conseil syndical financée par l’ARC Nationale, avec un de nos avocats référant, le 31 juillet dernier, une nouvelle décision judiciaire très intéressante a été prononcée.
En effet, le syndic SOCAGI et son assureur QPE ont été condamnés in solidum à verser à la copropriété 6 735 euros de pénalités de retard.
Néanmoins, ce qui est intéressant ce sont les arguments avancés par le syndic et l’assureur qui ont été tous deux retoqués par le Juge.
Tout d’abord, le syndic a indiqué que la procédure devait être reconnue comme irrecevable du fait qu’au jour de l’assignation, il n’était plus syndic.
Cet argument a été rejeté au motif qu’au jour de l’assignation, les pénalités étaient bien constatées et que le président du conseil syndical disposait bien d’un mandat en cours.
Cette analyse donne donc le feu vert à un président du conseil syndical d’agir en justice même après le départ du syndic qui n’a pas remis les pièces qui lui ont été réclamées.
Le deuxième argument évoqué par l’assureur est qu’il ne pouvait pas être appelé à la cause du fait que le syndic a commis une faute intentionnelle qui n’entre pas dans les fautes prises en charge dans le cadre du contrat.
Là encore, le Juge a retoqué l’argument de l’assureur en indiquant qu’il devait prendre des mesures à l’égard de son assuré surtout lorsqu’il a été expressément sollicité par le président du conseil syndical.
Total de la démarche : les deux ont été condamnés in solidum au versement des pénalités auxquelles s’ajoute la prise en charge des frais.
Au prochain numéro, l’ARC Nationale prend toujours en charges les frais.