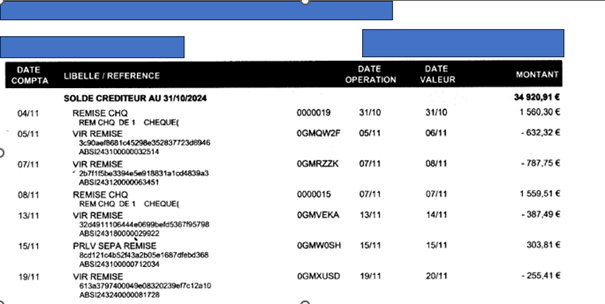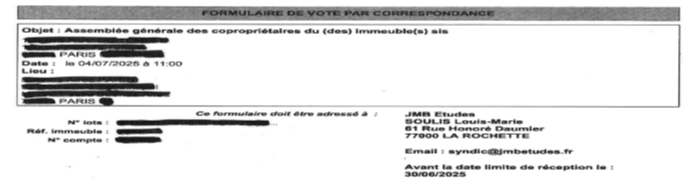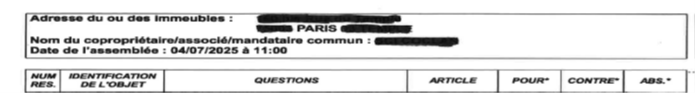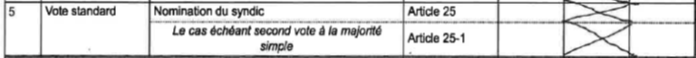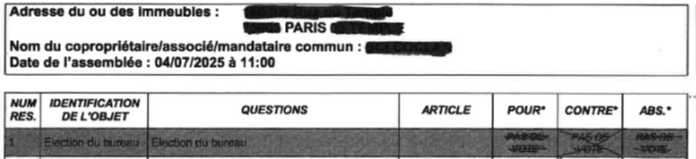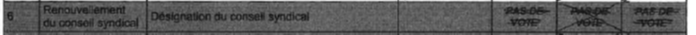Réponse :
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous touchez du doigt une question éminemment sensible qui a fait l’objet de nombreux articles publiés par notre association (voir ainsi un article publié dans la revue trimestrielle n° 144, en date du 2eme trimestre 2024), ainsi que de nombreuses formations ou conférences, également dispensées par notre association, et, aux termes de cette réponse, nous ne reviendrons pas sur l’intégralité de cette thématique.
Rappelons tout d’abord le cadre légal applicable.
L’obligation, pour les copropriétés, de faire établir un projet de plan pluriannuel de travaux (3PT) a été instituée par la loi dite « Climat et résilience » en date du 22 août 2021.
Cette loi est ainsi venue notamment modifier l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et a imposé l’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés dont la réception est intervenue il y a plus de quinze années.
De même, cet article prévoit que sont exonérées de cette obligation les copropriétés ayant fait établir un diagnostic technique global (DTG) ne faisant apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, ce qui correspond en pratique à une hypothèse très rare.
La mise en œuvre de cette obligation de réaliser un 3PT est intervenue de façon échelonnée, selon la taille des copropriétés.
Les copropriétés dotées de plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, devaient ainsi, dès le 1er janvier 2023, faire réaliser un tel projet.
Pour les copropriétés dotées de 50 à 200 lots « principaux », cette obligation entrait en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Enfin, les copropriétés dotées de moins de 50 lots étaient concernées à partir du 1er janvier 2025 ; de sorte qu’aujourd’hui, toutes les copropriétés, quelle que soit leur taille, même les plus petites, sont concernées.
Il faut rappeler par ailleurs que la réalisation d’un projet de plan pluriannuel n’est que la première étape de la procédure, et que, une fois le 3PT réalisé par l’architecte ou la société missionnée, il convient ensuite de le faire approuver en assemblée générale. L’approbation de ce projet peut être totale ou partielle. Une fois ce projet approuvé, on parle alors de plan pluriannuel de travaux, et non plus simplement d’un projet de plan…
Cela ayant été rappelé, quelles sont les sanctions si le syndicat des copropriétaires ne fait pas réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux ? Ou en fait réaliser un sans toutefois l’adopter ensuite en assemblée générale ?
Il faut tout d’abord rappeler, toujours en vertu de l’article 14-2 précité, que, dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, la mairie ou la préfecture, notamment, a la possibilité, à tout moment, de demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux ayant été adopté, et ce afin de « vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants. »
En l’absence de transmission de ce plan pluriannuel de travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, ou si le plan transmis « ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble », la mairie ou la préfecture pourra élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires, et aux frais de ce dernier. Une fois le projet de plan pluriannuel établi, celui-ci doit être notifié au syndicat des copropriétaires par l’autorité administrative. Le syndic doit alors convoquer une assemblée générale dès la notification de ce projet de plan, afin qu’elle se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan.
Dans cette optique, on peut toutefois penser que les pouvoirs publics vont d’ores et déjà concentrer leurs efforts sur les copropriétés qui présentent des désordres architecturaux notables.
Pour autant, est-ce une raison pour rejeter purement et simplement la réalisation d’un 3PT ?
L’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit à ce titre que, en cas de vente d’un lot appartenant à une copropriété ayant un usage total ou partiel d’habitation, doit être remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse de vente, notamment, le plan pluriannuel de travaux, ou, à défaut, le projet de plan pluriannuel de travaux.
Il est à noter en pratique que, d’après les retours des études notariales que nous avons eus, l’absence d’établissement de ce plan ou projet de plan ne fait aujourd’hui pas obstacle à la signature des actes de promesse de vente. Cela étant, les acquéreurs avertis pourraient tirer prétexte de cette absence de plan pluriannuel pour négocier une potentielle remise de prix auprès de leur vendeur, en arguant du fait, d’une part, qu’ils ne disposent pas d’une information suffisante sur l’état de la copropriété, et, d’autre part, qu’ils seront tenus, à échéance plus ou moins brève, de financer le coût de réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux.
Le dispositif étant encore assez récent, il n’est pas encore forcément très connu et maîtrisé par l’ensemble des professionnels de l’immobilier. On peut néanmoins penser que, dans les années à venir, son absence de réalisation par les copropriétés constituera un frein à l’achat de plus en plus notable. Dans cette optique, on pourrait même imaginer que les vendeurs éconduits se retournent contre le syndicat des copropriétaires et intentent une action en justice visant à indemniser une perte de chance d’avoir pu vendre leur bien à un certain prix…
Ne tardez donc pas à faire établir et adopter votre plan pluriannuel de travaux !