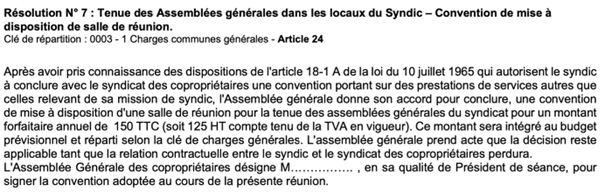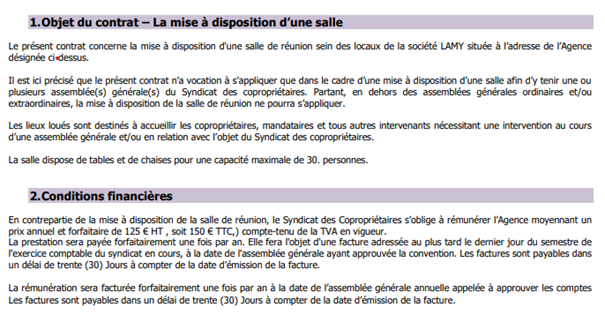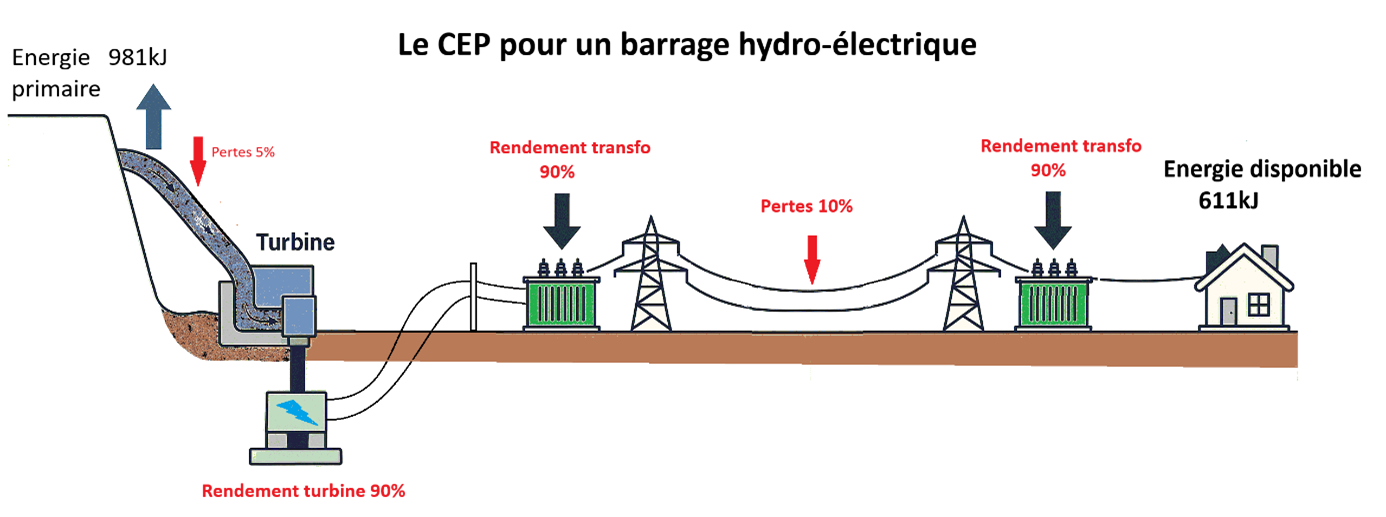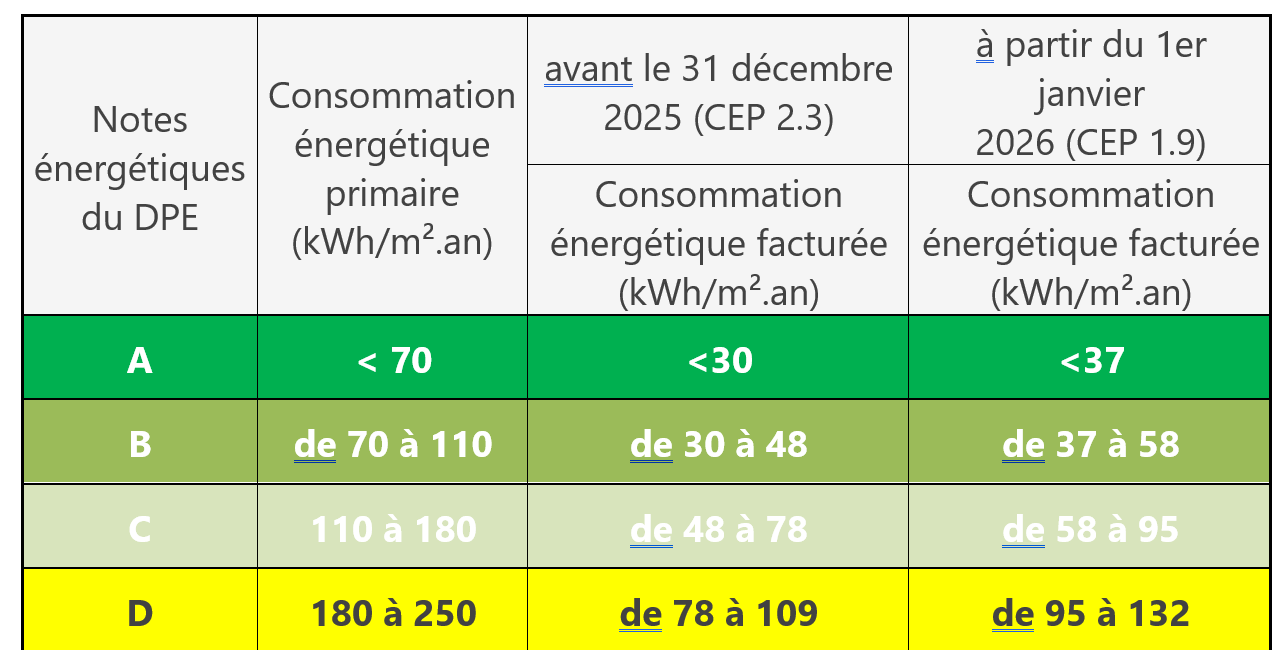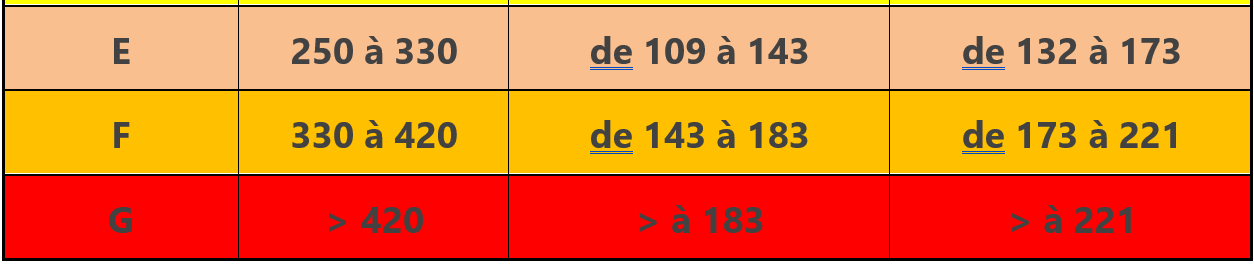Les visites de l’immeuble contractuelles de plus en plus nombreuses et de moins en moins réalisées
Le contrat-type de syndic impose de préciser les trois variables qui doivent être comprises dans les honoraires du forfait de base.
Il s’agit :
1) Du nombre de réunions entre le syndic et le conseil syndical en précisant le créneau dans lequel elles doivent se dérouler
2) La durée de l’assemblée générale et le créneau dans lesquels elles doivent être tenues
3) Le nombre de visite annuelle de l’immeuble qui doit être assuré par le syndic
Bien souvent, pour faire la différence avec la concurrence, les syndics professionnels prévoient dans leur contrat un nombre de visite de l’immeuble important qui n’est pas forcément réalisé ou du moins pas dans les conditions précisées.
Faisons un point sur les modalités contractuelles liées aux visites de l’immeuble en présentant la réalité de terrain.
I- Des visites encadrées par le contrat-type
Le point 7.1.1 du contrat-type impose de préciser les modalités de visite de l’immeuble assurée par le syndic qui sont incluses dans le forfait de base.
Trois indications doivent figurer :
a) le nombre de visite annuelle de l’immeuble,
b) si le syndic s’engage ou non à produire un rapport à la suite de ces visites,
c) si la présence du président du conseil syndical est indispensable.
Ces précisions sont loin d’être anodines entraînant des conséquences aussi bien juridiques que financières.
Dans la mesure où le contrat prévoit la production d’un rapport, le syndic devra établir à l’issue de chaque visite, une note faisant état de la copropriété en mettant en exergue les désordres constatés et les mesures envisagées pour les corriger.
L’absence d’annotation peut devenir stratégique si quelques jours voire quelques semaines plus tard, on constate un désordre ou carrément un écroulement partiel ou total ayant entraîné un préjudicie.
La responsabilité civile du syndic pourra alors être engagée au motif de son absence d’alerte auprès du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, à partir du moment où le contrat impose la présence du président du conseil syndical, le syndic ne pourra pas se déplacer quand il le souhaite, devant nécessairement se coordonner avec ce dernier pour déterminer les dates de visites.
Là encore, il s’agit d’un élément stratégique puisque le syndic ne pourra pas évoquer d’avoir réalisé les visites de l’immeuble à l’insu du président du conseil syndical.
II – Des visites de moins en moins fréquentes
De plus en plus de conseillers syndicaux nous font part de l’absence de visites de l’immeuble effectuées par leur syndic malgré la mention d’un nombre important dans le contrat.
Cela résulte d’un manque de temps des gestionnaires mais surtout de la « période covid » où ils étaient dispensés de se déplacer ayant à présent pérennisé cette situation.
Ainsi, volontairement, les syndics amalgament les visites de l’immeuble avec les réunions de chantier ou celles avec le conseil syndical.
Or, il ne faut pas confondre les usages d’autant plus que le montant du forfait de base a été calculé en prenant en considération le temps du gestionnaire nécessaire à se déplacer dans l’immeuble, indépendamment des réunions avec le conseil syndical ou de suivis de chantier.
Voilà pourquoi, il faut :
1) convenir du nombre de visites compris dans le forfait de base conformément aux besoins de la copropriété,
2) imposer la présence du président du conseil syndical lors de ces visites,
3) imposer la production d’un rapport que le conseil syndical devra lire et conserver afin de prévenir d’éventuels litiges notamment en cas de désordre sur la copropriété ayant entraîné un préjudice.